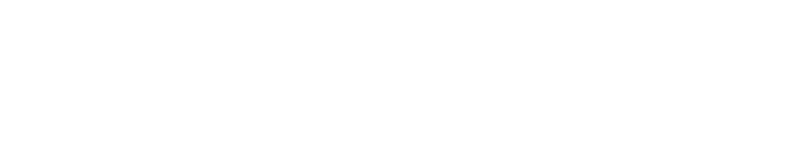Du 13 au 17 avril 2025, j’ai eu le plaisir d’effectuer un déplacement au Japon, à la rencontre de nos compatriotes installés dans l’archipel et des acteurs institutionnels, économiques et culturels franco-japonais. Ce programme dense et riche en échanges a été marqué par l’accueil chaleureux, l’engagement et la diversité des parcours de notre communauté, qui incarne avec force les valeurs et la vitalité de la France à l’étranger.
Osaka : une France à l’honneur à l’Exposition universelle
Mon déplacement a débuté à Osaka, le 13 avril, avec la visite du site de l’Exposition universelle 2025 et l’inauguration du Pavillon français, aux côtés du ministre du Commerce extérieur Laurent Saint-Martin, du commissaire général Jacques Maire, de Teddy Riner et de Sophie Marceau, parrain et marraine du Pavillon. Cet événement illustre l’engagement de la France dans les grands rendez-vous internationaux. La journée s’est clôturée par une réception organisée par la Chambre de commerce franco-japonaise du Kansai.
Kyoto : jeunesse créative et coopération scientifique
À Kyoto, les 14 et 15 avril, j’ai pu visiter le Lycée français international de Kyoto (LFIK), où j’ai été impressionnée par l’enthousiasme et la créativité des élèves, notamment par l’initiative remarquable des membres du CVC-CVL, qui ont lancé leur propre ligne de t-shirts et d’accessoires. J’ai également échangé avec la communauté éducative sur la mise en œuvre du programme EVARS et rencontré nos représentants de la communauté française.
J’ai eu des échanges passionnants avec les chercheurs de l’École française d’Extrême-Orient, dont les travaux scientifiques contribuent activement au rayonnement de la France.
Enfin, j’ai participé aux célébrations des dix ans du programme « métiers d’art » de la Villa Kujoyama et visité l’Institut Français du Kansai, notamment son exposition photographique pour le festival Kyotographie.
Kobé : amitié franco-japonaise et échanges
Le 16 avril à Kobé, j’ai rencontré les fondateurs du Musée Kitano et les représentants de la société franco-japonaise, avant de visiter la plaque de jumelage entre Marseille et Kobé, symbole fort de l’amitié franco-japonaise. Une réunion publique au Café de Paris, tenu depuis 20 ans par les frères Azzouz, a permis de dialoguer avec nos compatriotes sur les effets concrets de la situation internationale et les enjeux du quotidien.
Tokyo : diplomatie, économie et dialogue citoyen
Enfin, à Tokyo, j’ai eu l’honneur de dîner avec notre ambassadeur avant de m’entretenir avec M. Takashi Kozu, président du think-tank SAAJ, sur les grands enjeux économiques mondiaux. J’ai ensuite échangé avec les acteurs économiques, dont Business France, les CCEF et la French Tech, avant de visiter le Lycée français international de Tokyo. La journée s’est conclue par une réunion publique à la Maison franco-japonaise, en présence du député européen Sandro Gozi.
Une relation franco-japonaise dynamique et inspirante
Ce déplacement a confirmé, une fois encore, l’excellence de la relation franco-japonaise et l’engagement remarquable de nos compatriotes, qui font rayonner la France au-delà de nos frontières. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux que j’ai rencontrés pour leur accueil, leur engagement et la richesse des échanges.