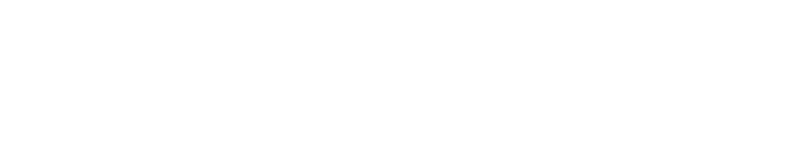Face à une école sous tension, nous avons besoin d’initiatives concrètes, de débats francs et d’une méthode exigeante pour remettre du sens au cœur de l’éducation. Le 12 juin, j’ai réuni à l’Assemblée nationale des élèves, des enseignants, des parents, des personnels éducatifs, pour un colloque consacré à un levier trop négligé : le temps. Une journée dense, utile, et qui appelle des suites.
Partir du vécu pour refonder l’école
Ce colloque, intitulé “Refonder l’école par le temps”, a commencé par une séquence volontairement atypique à l'Assemblée nationale : une “classe” réunissant une trentaine d’acteurs de terrain – élèves, enseignants, personnels de direction, parents – animée par Lucas Markarian, plus connu sous le nom de “Lucas Maths”, professeur de mathématiques et créateur de contenus pédagogiques sur les réseaux sociaux.
L’objectif ? Sortir des abstractions pour entendre ce que le temps scolaire fait vivre, ce qu’il permet, mais aussi ce qu’il abîme. Les échanges ont mis en lumière un besoin criant de cohérence, de respiration, de lien. Des propositions concrètes ont émergé, sans faux-semblants. Car pour refonder l’Ecole, il faut d’abord entendre ce que l’institution fait déjà bien et ce qu'elle pourrait mieux, ou différemment.
Une parole collective à faire entendre
L’après-midi a permis de prolonger les échanges de la matinée à travers des présentations d’experts, deux tables rondes de grande qualité, et la restitution des propositions issues de “la classe”, auxquelles nous avons pu répondre collectivement.
Le tout s’est déroulé devant une audience de plus de 170 personnes venues de toute la France. Parents, élèves, enseignants, personnels de direction, chercheurs, élus… Tous ont apporté leur voix et leur expérience pour poser les bons termes du débat.
Nous avons parlé de sommeil, de fatigue scolaire, de perte de sens, de décalage entre les horaires imposés et les besoins réels des enfants. Il a aussi été question de la place croissante des réseaux sociaux, du temps nécessaire à l’orientation, du temps pour les activités artistiques, sportives et périscolaires.
Et surtout, nous avons discuté de solutions : la nécessité de stabilité, de régularité, du respect des rythmes d’apprentissage, du droit au temps long pour bien apprendre. Ce colloque a aussi mis en lumière les tensions concrètes auxquelles sont confrontés les établissements et les collectivités locales : manque de marges de manœuvre, rigidité des cadres, insuffisance des moyens. La question de l’autonomie des académies et des établissements a ainsi émergé comme un levier possible, mais qui ne peut produire d’effet sans accompagnement durable.
Il y a, dans notre pays, une énergie éducative formidable, mais trop souvent dispersée, bridée, ou simplement ignorée. Mon objectif est clair : faire remonter cette parole collective dans le débat national, et la traduire en propositions utiles.
Construire, proposer, peser
Ce colloque n’était pas un simple échange : c’était un temps de construction collective. Il donnera lieu à des Actes, à une note de propositions, et à une contribution à la Convention citoyenne sur l’Éducation, qui s’ouvrira le 20 juin.
Car ce que nous avons entendu mérite mieux qu’un compte rendu. Cela appelle des choix, des arbitrages, des changements. Refonder l’École par le temps, ce n’est pas une lubie technique. C’est un acte politique.
Le prochain colloque du cycle “Le Sursaut” portera sur un sujet tout aussi décisif : l’autorité et le statut des professeurs.
Merci à tous les intervenants et à tous les participants pour la richesse de leurs contributions. Et à très bientôt pour continuer, ensemble, ce travail exigeant au service de l’école de demain.
L'intégralité du discours d'ouverture ici ⤵️
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Chers amis de l’École,
Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd’hui, à l’Assemblée nationale, pour ce premier rendez-vous du cycle « Le Sursaut ». Merci d’être venus de toute la France pour consacrer du temps à ce qui compte : notre École, notre avenir commun, nos enfants.
Avant toute chose, je souhaite dire un mot de ce drame de trop qui a frappé notre Ecole il y a 2 jours. Une de nos assistantes d’éducation a été poignardée à mort dans un collège de Haute Marne. Toutes mes pensées vont à sa famille et à toute la communauté éducative. Notre Ecole est en deuil. Notre République est en deuil. Et nous devrons y répondre collectivement. Je sais que l’école prendra sa part mais l’Ecole ne peut et ne pourra pas tout et pas toute seule.
Nous le savons tous ici : l’École traverse une crise. Une crise profonde, qui ne touche pas seulement les résultats ou les moyens, mais le sens, la confiance, parfois même le lien entre ses acteurs. Ce drame en est l’expression la plus cruelle. Personne ici ne fuit cette réalité — au contraire, chacun y répond déjà, avec courage. Dans mon dernier discours de ministre, j’ai dit : « l’École est malade ». Ce n’était ni un reproche ni une provocation, mais un appel. Un appel à secouer le système, à reconnaître les difficultés, à faire entendre une voix : celle de la reconnaissance, de la confiance, et de l’espérance.
Car oui, je le crois profondément : nous allons réussir ! Nous allons réussir parce que nous ne partons pas de rien. Sur tout le territoire, des femmes et des hommes agissent. Enseignent. Accompagnent. Innovent. Refusent de baisser les bras. Ils sont professeurs, chefs d’établissement, assistants d’éducation, animateurs, élus, parents d’élèves. Ils portent une idée simple : l’École peut tout changer. Et ils ont raison. L’École est notre socle. Elle est la mère de toutes les batailles. C’est à l’École que se construit l’avenir d’un enfant, la cohésion d’une société, la promesse d’une République juste.
C’est avec cette conviction profonde que j’ai voulu lancer la série d’évènements Le Sursaut. Parce que je ne peux pas me résoudre à voir notre École s’essouffler, à voir s’installer le doute et le découragement. J’ai voulu créer un espace exigeant et ouvert, un lieu où l’on puisse parler vrai, où l’on regarde les problèmes en face, sans jamais perdre de vue la foi dans l’avenir. Ce que je propose avec Le Sursaut, c’est un mouvement collectif pour replacer l’École au cœur de notre pacte républicain sans oublier de replacer les élèves au cœur de notre École.
Je crois en une méthode : celle du dialogue, de l’écoute, de l’intelligence du terrain. Les solutions ne viendront pas seulement d’en haut, ni de formules toutes faites ou de programmes tout construits. Non ! Les solutions sont déjà là, dans les projets locaux, dans les établissements, dans les classes. Elles sont portées par des responsables d’établissements ou inspecteurs motivés, des enseignants engagés, des collectivités innovantes, des élèves lucides.
Mon rôle, en tant que représentante de la Nation, c’est de créer les conditions pour que ces initiatives puissent grandir, s’articuler, être entendues.
Et puis, c’est aussi d’ouvrir une voie politique à ce qui fonctionne. Et j’insiste : une voie politique. Car il est de notre devoir, en tant que responsables politiques élus, d’assumer pleinement notre rôle vis-à-vis de l’École. Nous n’avons pas le droit de la reléguer au second plan de nos priorités. Ce qui se joue pour l’École engage le cœur même de notre contrat républicain. Et c’est pourquoi la parole politique doit s’en emparer, avec exigence, avec constance, avec hauteur. Avec courage.
Je le dis avec une certaine gravité : ce que nous faisons à l’Assemblée nationale n’est pas à la hauteur des enjeux. Les travaux parlementaires ne permettent pas d’aborder l’École dans toute sa complexité, ni dans toute son urgence. Nous devons faire mieux. Nous devons faire plus. Laisser penser que la politique est impuissante face à la crise de l’École, c’est abdiquer. Et l’impuissance politique, c’est ce qui ronge le cœur même de la démocratie. C’est ce qui alimente la défiance. C’est ce qui installe le fatalisme.
Mes chers amis, nous avons une responsabilité historique. Celle de faire de l’École une priorité stratégique. Celle de refuser les ajustements à la marge et les atermoiements. Celle d’oser une transformation de fond. L’École est un investissement. C’est le meilleur investissement que nous puissions faire pour notre pays : pour sa cohésion, pour sa prospérité, pour sa démocratie.
C’est pourquoi j’ai souhaité que ce premier colloque donne avant tout la parole à celles et ceux qui, au quotidien, expérimentent, adaptent et innovent : les professeurs, les élèves, les parents, les personnels éducatifs, les collectivités locales, les chercheurs, les associations. C’est de là que viennent les solutions. C’est là que réside notre espoir. Je pense notamment à ces écoles qui ont par exemple choisi de répartir les apprentissages fondamentaux le matin, moment où les enfants sont les plus attentifs, et les activités créatives l’après-midi. Je pense à ces communes qui, malgré des contraintes budgétaires fortes, ont maintenu la semaine de quatre jours et demi pour préserver des matinées d’apprentissage plus nombreuses. Je pense à ces enseignants qui, dans des contextes difficiles, choisissent une organisation de leur classe qui respecte les rythmes de l’enfant, sans renoncer à l’exigence. Ces initiatives existent. Elles fonctionnent. Elles inspirent. Ce que nous devons faire, c’est leur donner les moyens de se déployer, de se coordonner, de s’évaluer.
Ce matin, je voudrais aussi dire un mot des enseignants. Parce que trop souvent, on parle d’eux sans eux. Parce que trop souvent, on leur demande sans leur donner. Parce que trop souvent, on oublie que ce sont eux qui tiennent l’École – parfois à bout de bras mais toujours avec dévouement. Les professeurs doivent retrouver du temps. Du temps pour enseigner. Du temps pour préparer. Du temps pour évaluer. Du temps pour souffler aussi, parce qu’on ne transmet bien que lorsque l’on se sent bien. J’y reviendrai dans un prochain colloque.
Si j’ai choisi de commencer la question du temps scolaire, ce n’est pas un hasard. Derrière ce sujet apparemment technique se cache un enjeu fondamental : notre capacité à bâtir une École qui respecte les rythmes de l’enfant, réduit les inégalités et donne à chacun les moyens de réussir. Depuis trop longtemps, ce débat est figé. Parce qu’il dérange, on l’évite. Parce qu’il divise, on le diffère. Mais ce silence a un coût. Le temps scolaire n’est pas une affaire d’emploi du temps : c’est une question de justice, de santé, d’efficacité — et, au fond, d’humanité.
La Cour des comptes, dans son rapport de mai 2025, est sans appel : notre organisation actuelle fatigue les élèves, déséquilibre les apprentissages, aggrave les inégalités. Il faut du courage pour le constater. Il en faut plus encore pour agir. Pendant que des pays comme la Finlande, l’Estonie ou le Canada adoptent des rythmes plus respectueux du développement de l’enfant, pendant que des établissements français à l’étranger — à Hanoï, Manille ou Singapour — réinventent leurs horaires et leurs espaces pédagogiques, la France reste prisonnière de modèles dépassés, déconnectés des besoins réels des élèves. Ce colloque ne doit pas être un rendez-vous de plus. Il doit ouvrir un dialogue sincère entre tous les acteurs de l’École. Avec les moyens modestes d’un mandat parlementaire, j’ai voulu innover : interroger, écouter, impliquer — y compris les jeunes — et faire émerger, ensemble, un nouveau cap.
Ce matin, vous étiez réunis en « classe » : élèves, parents, professeurs, personnels éducatifs. Ce fut un moment rare, riche et stimulant. Cet après-midi, nous poursuivrons avec des experts, des chercheurs, des élus, et avec votre voix. Vous qui êtes ici avec nous, qui êtes dans la salle. Parce que vous êtes les premiers concernés. Parce que vous avez des idées, des solutions, une voix à faire entendre. Travailler sur les rythmes scolaires, ce n’est pas seulement revoir un calendrier ou ajuster une semaine. Il s’agit, plus profondément, de réhumaniser l’École. C’est rappeler que derrière chaque emploi du temps, chaque réforme, chaque circulaire, il y a une multitude de visages, de voix, de vies : des enfants, bien sûr, mais aussi des enseignants, des parents, des agents du périscolaire, des personnels de direction, des accompagnants – tous engagés, à leur manière, au service d’une même promesse.
Réhumaniser l’École, c’est d’abord redonner du sens. C’est reconnaître que l’élève n’est pas un résultat à produire, ni un niveau à valider, mais une personne à faire grandir.
Réhumaniser l’Ecole, c’est permettre aux enseignants de retrouver le temps, la confiance et les moyens d’exercer pleinement leur métier.
Réhumaniser l’Ecole, c’est associer les parents à une communauté éducative lisible et ouverte. Réhumaniser l’Ecole, c’est aussi valoriser pleinement le rôle des personnels périscolaires, piliers souvent invisibles mais essentiels du quotidien des élèves.
Réhumaniser l’École, c’est donc refuser la technocratie, reconstruire du lien, de la stabilité, et offrir à chacun des repères dans un monde incertain. Et cela suppose une refonte de notre rapport collectif au temps de l’enfant.
Réfléchir aux rythmes scolaires, c’est choisir d’écouter ce que la recherche nous dit sur le développement cognitif, affectif et social des élèves. C’est assumer que le temps n’est pas neutre. Qu’il peut être facteur de réussite ou, au contraire, d’épuisement. Qu’il peut être source d’égalité ou d’injustice. En repensant les rythmes, nous pouvons donner à chaque élève les conditions d’un parcours harmonieux et exigeant, sans renoncer ni à l’exigence ni à la bienveillance.
Alors oui, nous avons des défis à relever : reconstruire la confiance, redonner du sens, rééquilibrer le temps scolaire. Mais nous avons surtout une chance formidable : celle de pouvoir agir. Ensemble. Sans dogme. Sans tabou. Avec la volonté de bâtir, pas de dénoncer.
Chers amis, Je n’ai pas de formule magique à proposer. Mais j’ai la conviction que ce colloque peut apporter une pierre à l’édifice – être ce petit ruisseau qui engendrera une plus grande rivière. Enclencher une dynamique : de responsabilité, de respect, de résultats. De courage. Je veux que ce moment soit utile. Je veux qu’il nous engage. Qu’il débouche sur des propositions concrètes. Qu’il trace une route. Parce que notre École le mérite. Parce que nos enfants le méritent. Parce que notre pays en a besoin. Je formule donc un vœu ce matin. Que chacun d’entre vous, à l’issue de cette journée, reparte avec une conviction renouvelée :
● Oui, l’École peut redevenir un lieu de confiance, d’émancipation et de transmission.
● Oui, nous pouvons bâtir une École plus juste, plus humaine et plus efficace.
● Oui, nous avons en nous les ressources, les talents et les énergies pour y parvenir.Nous allons réussir. Parce que nous le voulons. Parce que nous le pouvons. Parce que nous le devons. Merci à chacune et chacun d’entre vous pour votre engagement. Merci pour votre écoute.
Et surtout : merci pour ce que vous faites, chaque jour, pour l’École de la République. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci.